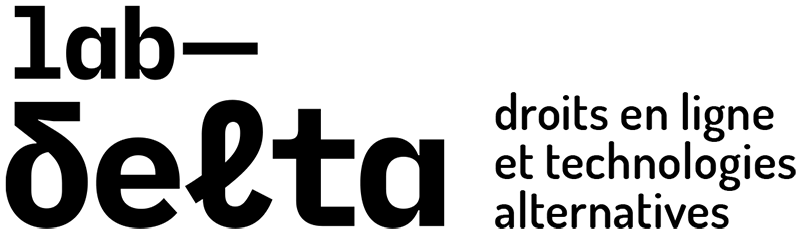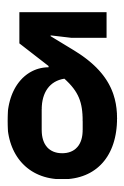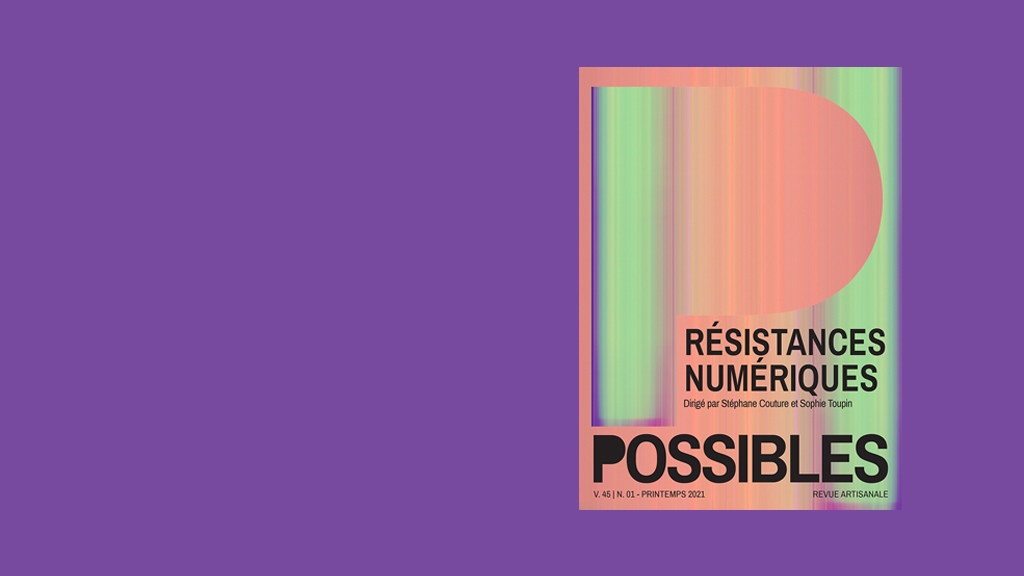Par Sophie Toupin
Résumé
Nous sommes en juillet 1990, six mois après la libération de Nelson Mandela d’une peine de vingt-sept ans de prison. La lutte contre le régime de l’apartheid fait toujours rage. Janet Love, une commandante d’Umkhonto we Sizwe (MK), la branche armée du Congrès national africain (African National Congress – ANC), s’est infiltrée illégalement dans un bureau à Johannesburg grâce à ses habilités de crochetage de serrure apprises quelques années auparavant à Cuba. Son objectif : envoyer un message par un moyen de communication chiffré, sans que ce dernier soit intercepté par le régime d’apartheid, pour organiser la lutte armée. Assise à une table, elle tient une petite enregistreuse collée à un téléphone fixe. Plus tôt dans la matinée, Janet a rédigé un message sur un ordinateur portable localisé dans une maison sûre tenue par un couple de Canadiens recruté récemment par le Parti communiste du Canada. L’ordinateur dont se sert Janet a été introduit quelques mois auparavant par Antoinette, une agente de bord hollandaise de KLM, militante du mouvement anti-apartheid. Une fois le message rédigé sur l’ordinateur, elle le chiffre, c’est-à-dire qu’elle le rend indéchiffrable, grâce à une disquette sur laquelle se trouve un algorithme de chiffrement avant de le faire passer par le port de série de l’ordinateur vers un modem à coupleur acoustique. Les données numériques formant le message texte sont ainsi converties en ondes sonores et sont par la suite capturées sur une petite enregistreuse. C’est ce dispositif, une enregistreuse discrète, que Janet tient présentement sur le récepteur téléphonique.
À l’autre bout du monde, à Londres en Angleterre, un téléphone est connecté à un répondeur téléphonique spécialement configuré par le réfugié sud-africain Tim Jenkin dans le but de recevoir un message chiffré. Pour être en mesure de le lire, Jenkin fait passer le message audio se trouvant sur le répondeur à travers un modem à coupleur acoustique. Cette procédure permet de convertir le son d’un signal analogue en un signal numérique et d’afficher le texte chiffré du message sur l’écran d’ordinateur. Le texte est déchiffré grâce la disquette sur laquelle se trouve l’algorithme de chiffrement. À la fin de ce processus, une simple chaîne de texte en clair apparaît sur l’écran d’ordinateur de Jenkin. Le message se lit comme suit : « [.] Très urgent !, très urgent !, très urgent ! Ce matin, l’une de nos agentes Paula a été arrêtée par la police sud-africaine. Paula avait l’habitude de transporter sur elle la disquette avec l’algorithme de chiffrement et quelques messages imprimés. Nous devons conclure que l’ennemi est au courant de notre réseau de communication et que celui-ci peut dorénavant déchiffrer nos communications [.] ».
À la lecture du message, Jenkin comprend immédiatement qu’il doit changer les clés de chiffrement pour protéger les communications futures du mouvement et que le message doit être transmis à Lusaka, en Zambie, où il peut être lu urgemment par la haute direction du Congrès national africain (ANC). Jenkins répète donc le processus de chiffrement et transmet le message à Lusaka. Là-bas une militante anti-apartheid néerlandaise nommée Lucia reçoit le message chiffré, le déchiffre et l’imprime sur papier. Un messager ramasse le message et se dirige vers le centre névralgique de l’ANC, où la haute direction en prend connaissance.
La démarche de Jenkin ne s’arrête pas là. Il transmet également le message aux chapitres zimbabwéen, néerlandais et canadien du système pour les informer de la situation critique et leur demande de rester sur un pied d’alerte. Comme le système de communication relie trois continents (Afrique, Europe et Amérique du Nord), tous les points de contact du système doivent impérativement être au courant de la situation en simultanément.
Infographie : Ariel Acevedo et Sophie Toupin. CC BY-NC-SA.
Cette introduction décrit sommairement l’une des manières dont un réseau de communication chiffré fonctionnait entre juillet 1988 et juin 1991, dans le cadre de la lutte contre l’apartheid. Cette infrastructure tricontinentale de communication, un véritable « Internet de l’ANC », sera intégrée à l’Opération Vula au cours des dernières années de la lutte de libération nationale. L’Opération Vula visait à ramener clandestinement en sol sud-africain des leaders de l’ANC, afin qu’ils puissent diriger le mouvement de masse pour en finir avec le régime d’apartheid. Par contre, bien avant la mise en service du réseau décrit ci-haut, le rêve de communications secrètes et rapides régnait dans l’esprit des combattant.e.s de la liberté sud-africain.e.s.
L’objectif de ce court article est d’une part de raconter l’histoire de la lutte contre le régime de suprématie blanche en Afrique du Sud par le truchement de l’analogique et du numérique. D’autre part, il s’agit de faire résonner le passé et le présent, afin de réveiller les matériaux mis en récit ici pour en tirer des leçons et pour qu’ils deviennent agissants sur le présent. Sur le plan méthodologique, cet article s’appuie sur une collecte de données mixtes, y compris des entretiens semi-structurés et des recherches dans les archives, réalisées au cours de mes recherches doctorales. Les combattant.e.s de la liberté qui ont développé et utilisé le système de communication chiffré ont été interrogé.e.s en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, au Canada et en Grande-Bretagne. Des recherches ont également été menées dans des archives personnelles et publiques en Afrique du Sud, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Une partie du récit et de l’analyse présentée dans la première section de l’article provient de ma thèse de doctorat (Toupin 2020). La deuxième section est une réflexion sur les leçons à tirer de cette étude de cas aujourd’hui.
Contexte sociohistorique
Pour mieux comprendre comment ce réseau de communication s’inscrit dans la lutte contre l’apartheid, il est important de faire un bond en arrière et d’expliquer brièvement le contexte d’émergence de la lutte (pour un bon et bref survol historique, se référer à Cherry 2012). Le Parti National de politique ethno- nationaliste blanche et afrikaner, élu en 1948 en Afrique du Sud, a commencé à instaurer un système législatif d’apartheid dans le pays. L’élection de ce parti s’inscrivait dans un long historique de colonisation et de colonie de peuplement néerlandaise et britannique, incluant l’esclavage, la migration forcée ainsi que la dépossession et l’exploitation des peuples d’Afrique Australe notamment. Après des décennies de résistance incluant la désobéissance civile, l’ANC a décidé d’adopter la stratégie de sabotage en visant les infrastructures d’apartheid. C’est suite au massacre de Sharpeville que la lutte armée est déclarée et que l’Umkhonto we Sizwe (MK), la branche armée de l’ANC est lancée. Le 21 mars 1960 des milliers de Sud- Africain.e.s ont convergé vers les commissariats de police pour protester contre les laissez-passer délivrés par le gouvernement qui les obligeaient à porter une carte d’identité lorsqu’ils et elles se trouvaient en dehors de leurs zones désignées, essentiellement un système interne de passeports utilisé pour maintenir la ségrégation raciale (Lodge 2011). Les forces de police blanches ont ouvert le feu sur les manifestant.e.s, tuant 69 personnes (peut-être beaucoup plus) et en blessant d’autres. Suite à la répression continue du gouvernement, en interdisant par décret les organisations politiques telles que l’ANC, les membres de ces dernières ont été forcés à la clandestinité. C’est dans cette foulée que ces militant.e.s ont été emprisonné.e.s, ou contraint.e.s à l’exil. L’externalisation de la lutte menée par des combattant.e.s pour la liberté loin des masses a nécessité un certain nombre de nouvelles réponses pour faire face à cette nouvelle situation. L’une de ces nombreuses réponses est venue de la part d’un comité technique.
Le comité technique
Le comité technique a été lancé dans les années 1950 par des membres du Parti communiste sud- africain (South African Communist Party – SACP) pour supporter l’ANC dans la lutte de libération. Le soutien du SACP à la lutte de libération nationale provenait de la 6e Internationale communiste de 1928 où il avait été décidé que « le rôle des communistes en Afrique du Sud était de travailler avec les mouvements nationaux naissants (l’ANC était spécifiquement mentionné) » (Cronin et Mohubetswane Mashilo 2015, 24). Le comité technique n’était pas pour autant une instance du SACP. Il répondait plutôt aux besoins techniques et communicationnels de la lutte contre le régime de l’apartheid, demandes qui pouvaient venir de l’ANC, du MK ou du SACP. Le comité technique initialement localisé en Afrique du Sud avait supporté les efforts de mise en place d’une radio clandestine, émettant au sein même du pays, et des pratiques de sabotage (telles que la fabrication de dispositif et de formation permettant de couper les fils du système téléphonique, saboter les voies ferrées, les centrales électriques, ainsi que les commissariats de police et les bâtiments gouvernementaux) vers la fin des années 1950 et le début des années 1960. Pourchassés par le régime pour leur savoir-faire, les membres du comité technique ont été contraints à l’exil en Angleterre où le comité a été reconstitué.
Malgré l’exil, les demandes des combattant.e.s de la liberté pour plus d’outils, de méthodes et de formations facilitant les opérations secrètes de déstabilisation du régime ont continué de s’accentuer auprès du comité technique. Or, ce dernier faisait face à de nouveaux obstacles : surveillance et censure accrue, brouillage des ondes courtes de radio, éloignement géographique d’un mouvement se trouvant sur plusieurs continents, entres autres. Dans ce contexte, le comité technique a développé au fil de trois décennies un répertoire de méthodes, de pratiques et d’outils communicationnels et technologiques pour supporter la lutte. Les pratiques (papiers, langagières, analogiques ou numériques) ont évolué tout au long de la lutte selon le contexte social, économique, politique (local, régional et international) et technologique ainsi qu’avec l’adoption (ou la non-adoption) par les militant.e.s de ces dernières. Je brosse ici-bas un bref tableau de quelques pratiques et outils développés par le comité technique voués à protéger les communications orales et écrites des militant.e.s, à inciter à l’action, à défier la censure et la surveillance, et à s’organiser collectivement.
Dès les années 1950, le comité technique a développé un nouveau langage codé ou « double langage » qui consiste à dissimuler ce qui était discuté à l’écrit ou à l’oral de sorte que seules celles qui connaissaient les codes étaient capables de comprendre les messages. Le langage codé dit du « jardinage » était par exemple utilisé pour faire référence aux activités politiques. Être jardinier signifiait être impliqué dans des activités subversives, si les mauvaises herbes poussaient parmi vos fleurs, alors vous étiez infiltré. Les parasites et les champignons étaient la police et les informateurs. En plus du double langage, une technique de cryptographie manuscrite a rapidement été développée pour chiffrer des messages écrits à la main. À l’époque, cette technique était largement utilisée par les mouvements de libération dans les Caraïbes, en Afrique, et en Asie. Malgré le fait que la cryptographie était essentielle, puisque les messages devaient souvent voyager par-delà plusieurs frontières, ce type de communication était si exigeant – un message pouvait prendre 24 à 48 heures à être chiffré et aussi long à être déchiffré – que peu de militant.e.s l’utilisaient sur une base régulière. C’est l’une des raisons qui poussera le comité technique à expérimenter avec l’automatisation du chiffrement pour sauver du temps, pour faciliter la tâche communicationnelle des militant.e.s et pour leur assurer plus de sécurité dans leur action.
Au début des années 1970, le comité technique a développé des dispositifs communicationnels poussant les sud-africain.e.s à l’action. Il s’agissait de « bombes audios » et de « bombes de tracts ». Une bombe audio consistait en une petite boîte qui dissimulait un amplificateur audio connecté à un magnétophone. Ce dispositif avait soit été infiltré dans le pays par une messagère, soit avait été fabriqué sur place. Ces boîtes étaient laissées dans une zone bondée d’un township par une combattante pour la liberté et, grâce à un dispositif de chronométrage, « explosaient » pour faire jouer un court message audio (pendant environ cinq minutes) une fois l’agente éloignée. Les messages audios pouvaient consister en des discours enregistrés d’un leader en exil, comme Olivier Tambo, le président de l’ANC, appelant la population à l’action pour rendre le pays ingouvernable. Ses dispositifs avaient été conçus parce qu’il y avait des doutes de la part du comité technique que les émissions de radio internationales sur ondes courtes préparées par la Radio Freedom depuis la Tanzanie puissent facilement être entendues par la population. En effet, le régime de l’apartheid s’affairait à brouiller les ondes radios (Lekgoathi, Moloi et Saíde 2020). Pour accompagner ces « bombes audios », le comité technique a développé le « bombardement de tracts » (leaftlet bombing) un dispositif permettant de diffuser des documents écrits et des nouvelles du mouvement de libération dans un pays où l’ANC, le MK et le SACP et leurs messages étaient interdits. Des miliant.e.s formé.e.s en cellule active de deux ou trois personnes imprimaient des tracts la nuit et les faisaient « exploser » dans des endroits très fréquentés pendant la journée. La petite détonation dans les lieux publics attirait l’attention, créait une pluie de tracts aériens, défiait la censure de l’apartheid et ralliait les Sud-Africain.e.s à la cause anti-apartheid.
Avec l’émergence des ordinateurs personnels et de la télématique (ordinateur + téléphone) vers la fin des années 1970 et le début des années 1980, le comité technique a reconnu l’importance de développer un moyen de communication informatique rapide, secret et transnational pour organiser la lutte et éviter la surveillance. C’est grâce à l’esprit d’expérimentation des membres du comité technique pour la programmation informatique et la cryptographie informatisée, ainsi que leur curiosité implacable sur la façon dont les choses sont faites que ceux-ci ont commencé à investir temps et énergie dans la sécurité communicationnelle du mouvement. Cette communication tricontinentale était ancrée dans la conviction que des lignes de communication sécurisées et chiffrées devaient être ouvertes entre les combattant.e.s de la liberté sur le terrain en Afrique du Sud, les recruteurs et recruteuses en Angleterre, aux Pays Bas et au Canada, et les dirigeants en exil en Zambie.
Dès la fin de l’année 1988, plusieurs messages s’échangeaient régulièrement. Les camarades Janet Love et Susan Tshabalala qui opéraient le système depuis l’Afrique du Sud envoyaient des informations sur la réalité du terrain, en plus de communiquer des informations logistiques et organisationnelles. Le système a permis, par exemple, de faire parvenir en Afrique du Sud des publications comme Umsebenzi, le bulletin trimestriel du SACP, Sechaba et Mayibuye, deux bulletins de l’ANC, qui étaient souvent produits à Londres. Désormais, chaque nouveau numéro pouvait être reçu, imprimé et distribué en Afrique du Sud presqu’au moment même de sa parution en Grande-Bretagne. Il n’était plus nécessaire de faire appel à des messagers pour les livrer depuis la Zambie ou le Royaume-Uni.
Au début du mois de juillet 1990, la police sud-africaine a arrêté deux cadres de l’ANC à Durban et a trouvé en leur possession des disquettes contenant une liste de noms, de lieux de refuge et de numéros de téléphone britanniques. Après cette découverte, d’autres camarades de lutte ont été arrêté.e.s, certain.e.s sont entré.e.s encore plus profondément dans la clandestinité, et les Néerlandais.e.s et les Canadien.ne.s ont fui le pays. Lorsque les combattant.e.s pour la liberté ont été amnistiés quelques mois après leur arrestation et libérés de prison en 1991, les Sud-Africain.e.s exilé.e.s sont revenu.e.s dans le pays et l’Opération Vula a cessé d’exister. De son coté, Tim Jenkin revenu au pays après 13 ans d’exil a commencé à travailler pour l’ANC, mettant en place une infrastructure informatique dans tout le pays à l’approche des élections de 1994. L’objectif de ce nouveau système était de compiler les données de toutes les différentes régions du pays, afin de comprendre les tendances électorales. Une fois l’ANC élu en avril 1994, Jenkin a constitué une équipe chargée de créer et de gérer les sites web des différents ministères et du parlement de l’ANC, d’établir les courriels et de former le personnel à leur utilisation.
Quelles implications pour aujourd’hui ?
Quelles sont les leçons à tirer de cette étude de cas qui se penche sur les pratiques de communication et d’organisation par le numérique au service d’un mouvement de libération ? De quelle manière certaine des connaissances et des pratiques analogiques et numériques brièvement décrites ci-haut peuvent- elles inspirer les mouvements de justice sociale aujourd’hui? J’explore dans cette dernière section quelques pistes pour alimenter une réflexion sur la relation entre numérique et résistance.
Tout d’abord, force est de constater que la création d’un comité technique au service du mouvement de libération en Afrique du Sud a donné lieu à d’intéressantes pratiques. Un petit groupe d’individus s’est affairé à développer ses habilités techniques pour permettre aux combattant.es de la liberté d’améliorer leur sécurité dans le cadre de l’organisation d’une lutte de libération. Ceci n’est pas sans rappeler la section technique au sein du Front de Libération Nationale (FLN) dont parle Frantz Fanon ([1959]1972) dans « Ici la voix de l’Algérie ». Même constat pour le développement des collectifs technologiques tels que Riseup et Autistici qui ont vu le jour à la fin des années 1990, dans le cadre des mouvements anti-/alter- mondialisation. Ces collectifs avaient (et ont toujours) pour but de fournir des outils de communication autonomes non commerciaux pour que les mouvements sociaux puissent s’organiser en toute sécurité sur des plateformes et des infrastructures dites alternatives.
Plus récemment, des autochtones, des personnes racisées et des féministes/LGBTQIA+ ont non seulement développé des cadres conceptuels forts pour appuyer leurs revendications (tels que la souveraineté des données, l’abolition des données de masse et les infrastructures féministes), mais aussi se sont emparés du numérique pour créer des infrastructures qui leur ressemblent, les représentent et répondent à leurs besoins et ceux de leurs communautés. À titre d’exemple, des féministes ont développé des infrastructures numériques féministes, telles que des serveurs féministes (voir Spideralex dans ce numéro). On peut aussi noter la demande d’abolition des données de masse et de leur partage auprès des communautés noires et sans-statuts, prolongement de l’idée du désinvestissement et ultimement de l’abolition des services de police, reconnus comme étant anti-noir.e.s, anti-migrant.e.s et anti-pauvres, ainsi que de la surveillance biométrique de masse qui font l’objet de campagnes de mobilisation en Europe (la campagne Reclaim your Face), aux États-Unis (Data4BlackLives), et en Afrique du Sud (Rights2Know). La pluralité de ces initiatives démontre bien l’effervescence de ces projets et leur appui sur des cadres théoriques empreints de la pensée radicale noire, africaine, caribéenne et féministe intersectionelle, entre autres.
Deuxièmement, comment l’exemple du comité technique de l’ANC complexifie-t-il notre façon de penser la communication et les technologies numériques d’un point de vue résistant ? Quels sont les paradoxes qui émergent ? Nul doute que cette étude de cas rend visible une tradition de contestation engagée et dynamique dans la manière dont les sud-africain.e.s se sont affairé.e.s à créer des formes de communication analogique et numérique pour faire avancer la lutte de libération. Les connaissances et les artefacts techniques développés ont émergé dans le processus de la lutte et ont été marqués par les circonstances de leur production, c’est-à-dire un développement technologique et communicationnel qui s’ancrait à court et moyen terme dans un contexte d’ingouvernabilité et de déstabilisation du régime en place, et à long terme dans la réalisation d’une émancipation sociopolitique et économique (toujours en cours). Qui plus est, aucun des outils développés par le comité technique n’a servi à concurrencer d’autres nations, ou à acquérir une position dominante sur le marché, mais plutôt à favoriser la libération d’un peuple. Les implications pour la résistance numérique aujourd’hui incluent la production de pratiques et d’outils qui émergent des processus de lutte et non pas d’un schéma directeur ; le fait que les collectifs technologiques travaillent au service des mouvements sociaux et non pour leur seul institutionnalisation ou pérennité; et l’importance de s’attarder à la création d’une infrastructure numérique contrôlée par les mouvements de justice sociale dont les paramètres, les critères de développement, le refus de la capitalisation monétaire et les finalités de leur utilisation servent le bien-être des communautés et de leurs luttes. D’ailleurs, aucun des outils développés durant le mouvement anti-apartheid n’a perduré une fois que le régime tombé. Cependant, et il est important de le mentionner, c’est précisément grâce à leurs expériences avec les technologies de pointe pendant la lutte de libération que l’ANC (et notamment la police, les militaires et l’agence de renseignement sud-africaine aujourd’hui) a fini par comprendre et apprécier le pouvoir des nouvelles technologies, en particulier les technologies de surveillance, dont ils se servent dans l’ère postapartheid pour espionner leur population, en particulier les sans-statuts, les travailleur.euse.s et les étudiant.e.s (Duncan 2018).
Troisièmement, comment une telle étude de cas s’inscrit-elle dans l’histoire des réseaux de communication numérique? Cette pratique du comité technique incluant le développement de son réseau de communication chiffré ajoute de la richesse et une couche de complexité à l’histoire des réseaux de communication. L’expression « Internet de l’ANC » a été utilisée par certaines personnes que j’ai interrogées lors de mes recherches doctorales pour résumer leur compréhension du réseau de communication tel que décrit en début de ce court article. L’idée d’un « Internet de l’ANC » résonne dans notre imaginaire, puisque ce dernier reliait une poignée d’ordinateurs opérés par des combattant.e.s de la liberté situé.e.s sur trois continents (Afrique, Europe et Amérique du Nord). L’expression résonne aussi bien avec les discussions actuelles sur la pluralité de la signification des termes « souveraineté » technologique, numérique, de données et de réseaux utilisés au sein des mouvements sociaux, des groupes autochtones et des pays comme la Chine et la Russie (Couture et Toupin 2019).
Quatrièmement, qu’elle est la place du « secret radical’ » (Birchall 2021) dans les luttes militantes d’hier à aujourd’hui? Comme le montre l’exemple du réseau de communication chiffré, l’opacité numérique obtenue grâce à l’utilisation du chiffrement et le besoin du secret au sein même du mouvement ont été des conditions sine qua non de son existence. Que peuvent tirer les mouvements sociaux aujourd’hui de cette pratique dans une période où la transparence à tout prix semble souvent prioritaire? Clare Birchall (2021) suggère que les pratiques des mouvements sociaux aujourd’hui sur le numérique seraient mieux servies par une forme radicale du secret plutôt qu’une forme de transparence radicale (c’est-à- dire de tout publier), puisque les États et les géants du web détiennent un avantage asymétrique en matière de contrôle des données et des infrastructures. En plus, cette posture propose un changement de paradigme qui ne fait pas valoir la protection de la vie privée, posture qui atomise puisqu’elle fait perdre de l’efficacité au mouvement en la renvoyant à la sphère individuelle, mais davantage au droit à l’opacité numérique comme démarche de résistance collective. En dissimulant ce que les mouvements sociaux font sur Internet, ils brouilleraient ainsi les pistes du capitalisme numérique et de surveillance, et pour ce faire amplifieraient la résistance numérique.
Finalement, quels sont les mythes actuels sur la technologie, incluant la résistance par le numérique, qui doivent être démantelés ? La croyance selon laquelle la technologie vient de l’Occident, que le monde occidental maîtrise la technologie, et que les technologies numériques (commerciales notamment) ont obligatoirement des capacités émancipatrices et démocratisantes (telles Facebook, Instagram, WhatsApp et Twitter) reste trop répandue. Et ce, malgré le fait que des féministes et des autrices anticoloniales aient démontré que la science et la technologie ont été co-construites, et que la technologie et la société sont mutuellement constituées (Harding 2008 ; Mavhunga 2015). À cet égard, Sandra Harding (2008) pose la question suivante : quel rôle les sciences et les technologies occidentales ont-elles joué dans l’histoire coloniale, et quel rôle le colonialisme a-t-il joué dans l’histoire des sciences et technologies occidentales? Bien que de nombreuses études aient répondu à ces questions et démontré ses imbrications, nous devons poursuivre nos recherches sur la manière dont les technologies et les infrastructures de communication ont informé et soutenu les luttes de libération nationale, et vice versa. Ce n’est qu’en creusant davantage dans les traditions anticoloniales que nous aurons accès à un ensemble différent de matériaux et d’idées pour réfléchir à la technologie et à la communication numérique. Cela peut se faire en apportant des perspectives anticoloniales et en mobilisant les traditions radicales à la recherche (telles que noires, autochtones, caribéennes, africaines et asiatiques) afin de briser les cycles de silence qui renforcent ces mythes. Remettre en question les histoires que nous avons héritées de la technologie et du numérique nous permettra d’y penser différemment et d’apporter un ensemble d’approches plus riches pour les comprendre. Défaire les mythes et rendre visible les silences est une démarche décoloniale qui donne accès à des récits alternatifs.
Biographie
Sophie Toupin est une chercheuse postdoctorale du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) à l’Université d’Amsterdam où elle explore les liens entre féminismes intersectionnels, données et infrastructures numériques. Elle détient un doctorat en communication de l’Université McGill.
Références
Birchall, Clare. 2021. Radical Secrecy : The Ends of Transparency in Datafied America. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Cherry, Janet. 2012. Spear of the Nation (Umkhonto Wesizwe) : South Africa’s Freedom Fighters, 1960s-1980s. Athens: Ohio University Press.
Couture, Stéphane et Sophie Toupin. 2019. « What does the notion of “sovereignty” mean when referring to the digital? » New Media & Society, 21(10): 2305–2322.
Cronin, Jeremy et Alex Mohubetswane Mashilo. 2017. « Decentring the question of race : Critical reflections on colonialism of a special type », dans : E. Webster et K. Pampallis (Dir.), The unresolved national question in South Africa: Left though under apartheid and beyond, pp. 20-41. Johannesburg: Wits University Press.
Duncan, Jane. 2018. Stopping the spies constructing and resisting the surveillance state in South Africa. Johannesburg: Wits University Press.
Fanon, Frantz. [1959]1972. Sociologie d’une révolution (L’an v de la révolution algérienne). Paris : F. Maspero. Harding, Sandra. 2008. Sciences from below: feminisms, postcolonialities, and modernities. Durham: Duke University Press.
Lodge, Tom. 2011. Sharpeville: an apartheid massacre and its consequences. Oxford: Oxford University Press.
Mavhunga, Clapperton. 2015. « Guerrilla healthcare innovation : creative resilience in Zimbabwe’s chimurenga, 1971-1980 », History and Technology, 31(3): 295–323.
Sekibakiba Peter Lekgoathi, Tshepo Moloi et Alda Româo Saute Safde (eds). 2020. Guerrilla Radios in Southern Africa: Broadcasters, Technology, Propaganda Wars, and the Armed Struggle. Lanham: Rowman & Littlefield.
Toupin, Sophie. 2020. « Technically Subversive : Encrypted Communication in the South African National Liberation Struggle ». Thèse de doctorat. Université McGill.